![]()
Les lentilles minces convergentes.
Cours
|
|
Les lentilles minces convergentes. Cours |
|
|
|
|
|
1)- Exercice 3 page 270 : Représenter les points caractéristiques.
2)- Exercice 4 page 270 : Comprendre la construction d’une image. 3)-
Exercice 5 page 270 : Construire une
image. 4)-
Exercice 6 page 270 : Le grandissement. 5)-
Exercice 10 page 271 : Le projecteur de
diapositives. 6)-
Exercice 11 page 271 : Défaut de l’œil. 7)-
Exercice 15 page 272 : Exercice à
caractère expérimental.
9)- Exercice 17 page 272 : Accommodation de l’œil.
10)- Exercice 19 page 272 : Formation d’une image sur la rétine.
11)- Exercice 21 page 274 : Les lentilles liquides. |
1)-
Propagation de la lumière.
-
La lumière n’a pas besoin de
milieu matériel pour se propager.
-
La lumière se propage en ligne
droite dans un milieu transparent homogène.
-
Chaque point d’une source de
lumière envoie de la lumière dans toutes les directions suivant des droites.
-
On utilise le modèle du rayon
lumineux. Il donne la direction de propagation de la lumière ainsi que le sens
de propagation.
-
Un faisceau lumineux est un
ensemble de rayon lumineux (le rayon lumineux n’existe pas).
-
On distingue : le faisceau
parallèle, convergent et divergent.
|
Faisceau
parallèle |
Faisceau
convergent |
Faisceau
divergent |
-
La lumière se propage dans le vide
avec une célérité c = 3,00 × 108
m/s.
2)-
Réflexion et réfraction de la lumière.
-
Lois de Snell-Descartes :
-
Loi de
-
Loi de
II-
Description des lentilles minces convergentes.
1)-
Classification des lentilles minces convergentes.
-
Une lentille mince est un milieu
transparent solide (verre, quartz, …) limité par deux calottes sphériques ou par
une calotte sphérique et un plan.
- L’axe qui joint les centres des 2 sphères est un axe de symétrie pour la lentille.
- On l’appelle l’axe principal
optique.
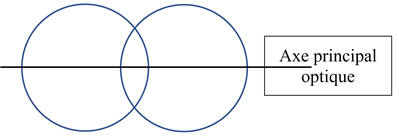
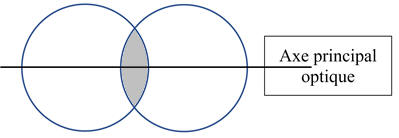
-
Une lentille est dite mince si son
épaisseur e
mesurée sur son axe est très petite devant les rayons de courbure de ses faces.
-
On distingue :
|
biconvexe |
plan convexe |
ménisque
à bords
minces |
-
Remarque :
-
Les lentilles minces convergents
sont plus minces aux bords qu’au centre.
2)-
Représentation symbolique des lentilles minces :
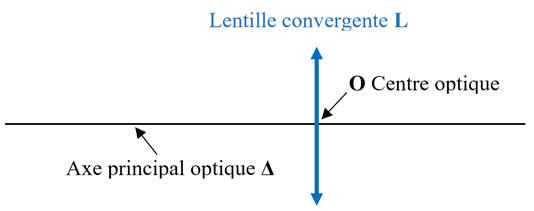
-
Le centre optique est le point où
l’axe principal optique traverse la lentille.
-
On le note toujours
O.
3)-
Propriété du centre optique :
-
Tout rayon lumineux qui frappe la
lentille à son centre optique la traverse sans déviation.
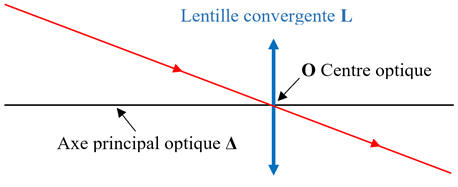
4)-
Foyer image et distance focale.
-
Tout rayon incident parallèle à
l’axe principal d’une lentille convergente en émerge en passant par le point
F’
appelé foyer - image de la lentille.
-
Le point
F’
est situé après la lentille.
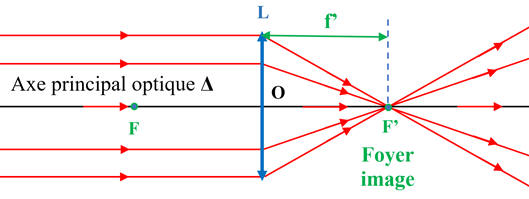
-
La distance
f’ est appelée : distance focale de la
lentille convergente.
-
Tout rayon incident passant par le
point appelé foyer-objet F
émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique
Δ.
-
Le point F
est appelé le foyer - objet,
ce point est réel. Il est situé en avant de la lentille.

-
Une lentille mince est
caractérisée par trois points particuliers :
-
Son centre optique
O ;
-
Son foyer image
F’ ;
-
Son foyer objet
F.
-
Représentation symbolique :
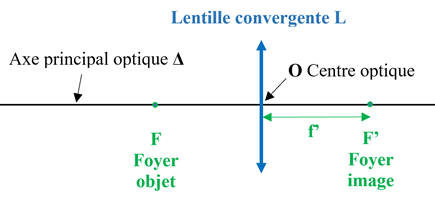
-
La distance focale d’une lentille
convergente :
-
La distance focale
f’ est définie comme la distance entre
le centre optique O et chacun
des foyers F et
F’.
-
Le foyer objet
F et le foyer image
F’ sont symétriques par rapport au
centre optique O.
- La loi du retour inverse de la lumière permet de dire que tout rayon passant par F,
symétrique de
F’
par rapport au centre optique
O
émerge parallèlement à l’axe optique Δ.
III-
Image
d’un objet dans une lentille convergente mince.
- L’objet est toujours noté AB.
- Le point A est situé sur l’axe principal et le point B est tel que AB est perpendiculaire à l’axe principal optique.
- L’objet
AB se situe dans un plan de front.
-
Méthode générale :
-
On cherche l’image du point
B
en considérant
2
ou
3
rayons particuliers issus du point
B.
-
L’image
B’
du point B
est l’intersection, après traversé de la lentille des rayons qui proviennent du
point
B.
2)-
Production d’une image réelle.
-
L’image d’un objet produite par
une lentille est qualifiée de réelle si elle est visible sur un écran.
-
Lorsque la distance entre l’objet
est la lentille est supérieure à la distance focale
f’,
l’image produite est réelle.
3)-
Construction d’une image réelle.
-
Application :
-
Données :
Diamètre de la lentille : 6,0 cm
-
Distance focale :
f’ = 2,0 cm
-
L’objet est perpendiculaire à
l’axe optique.
-
Objet
AB
= 1,0 cm
-
L’objet
AB est situé avant le foyer-objet à 1,5 cm du
foyer-objet.
-
Réaliser la construction en
utilisant la méthode suivante :
-
Rayon 1 :
issu du point B
et passant par le centre optique : il n’est pas dévié.
-
Rayon 2 :
issu du point
B
et parallèle à l’axe optique. Il émerge de la lentille en passant
par le point
F’
foyer - image.
-
Rayon 3 :
issu du point
B
et passant par
F
(foyer - objet). Il émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique.
-
Les mesures :
-
f’ =
2,0 cm
-
AF =
1,5 cm
-
AB =
1,0 cm
-
A’B’
≈ 1,3 cm
-
Remarques :
-
Les trois rayons se coupent en
B’
image de
B.
-
L’image
A’
de A
est la projection orthogonale de
B’ sur l’axe principal optique.
-
L’objet
AB
est réel et l’image
A’B’
est réelle et renversée.
-
Dans le cas présenté, l’image est
plus grande que l’objet.
-
La construction de l’image
A’B’ permet de déterminer
graphiquement sa position, sa taille et son sens.
-
La valeur absolue du grandissement
γ
permet de comparer la taille de l’image formée par une
lentille à celle de l’objet.
![]()
-
En utilisant le théorème de Thalès appliqué
aux triangles OAB et
OA’B’ (voir la figure ci-dessus):
-
On peut écrire la relation suivante :
-
![]()
-
Il faut exprimer les grandeurs
dans la même unité pour éviter les erreurs.
-
Si | γ
| > 1, l’image est plus grande que l’objet.
-
Si | γ
| < 1 , l’image est plus petite que l’objet.
-
Dans le cas précédent,
-
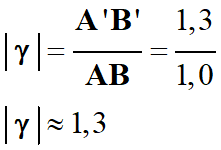
IV-
Le
fonctionnement de l’œil.
►L’œil peut être assimilé à une
sphère, de 2,3 cm de diamètre, limitée par une membrane très résistante et
sombre : la sclérotique.
-
Schéma :
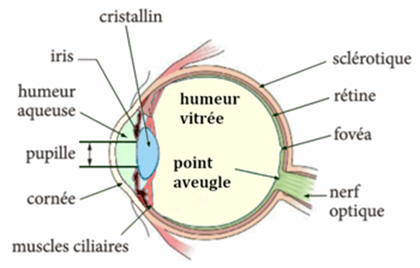
►Comme dans le cas des instruments
d’optique, on retrouve :
-
Un ensemble optique assurant la
formation des images.
-
Les rayons lumineux traversent une
succession de milieux transparents d’indices de réfraction différents :
-
La cornée (n = 1,376),
-
L’humeur aqueuse (n = 1,337), le
cristallin (n = 1,437 : il a la forme d’une lentille biconvexe), l’humeur vitrée
(n = 1,337).
-
La pupille, ouverture circulaire
(dont le diamètre varie de 2 mm à 8 mm), joue le rôle de diaphragme.
-
Elle règle le flux lumineux.
-
La rétine, membrane tapissée de
cellules photosensibles (cônes et bâtonnets), joue le rôle de récepteur de
lumière.
-
En simplifiant, on peut résumer le
mécanisme de vision de l’œil ainsi :
-
La pupille joue le rôle de
diaphragme
-
L’ensemble {cristallin + cornée}
peut être assimilé à une lentille convergente L
à laquelle on appliquera les lois des lentilles minces.
-
Quand on « accommode », la
vergence de cette lentille augmente.
-
Pour voir nettement, un objet, il
faut que l’image se forme sur la rétine située 17 mm derrière la lentille
L.
-
Faire un schéma du dispositif
expérimental permettant de modéliser l’œil. Indiquer les dimensions.
-
Schéma :
|
Œil |
Modélisation |
Appareil photo |
|
Pupille |
Diaphragme |
Diaphragme |
|
Cristallin -
cornée |
Lentille
convergente |
Optique |
|
Rétine |
Écran |
Capteur
|
-
Remarques :
-
L’image formée sur la rétine est
renversée. C’est le cerveau qui permet d’interpréter à l’endroit les images
renversées sur la rétine.
-
Pour que l’image d’un objet proche
se forme sur la rétine, le cristallin se déforme, ce qui modifie la distance
focale f’. On dit que l’œil
accommode.
-
Si l’objet est suffisamment
éloigné, l’image se forme sur la rétine sans que l’œil accommode. On dit que
l’œil est au repos.
- Au cours de la séance de travaux pratiques, on modélise un œil normal au repos à l’aide d’un tube cylindrique, de longueur ℓ1,
- aux extrémités duquel sont fixés une lentille convergente et un écran (verre
dépoli ou papier translucide).
-
Pour fabriquer
l’œil modélisé normal, on place l’écran (la rétine) à 17 cm de la lentille.
a)-
Description simplifiée
-
On nomme la « longueur » de l’œil,
la distance CR = 23 mm
-
On considère que, du point de vue
optique, l’ensemble de l’œil est assimilable à une lentille mince dont le centre
optique est situé au point O, milieu du segment
AB.
-
La cornée et l’humeur vitrée sont
deux éléments du système optique constitué par l’œil
-
L’iris est un diaphragme pigmenté
dont l’ouverture, commandée par réflexe, règle la quantité d’énergie lumineuse
qui pénètre dans l’œil
-
Le cristallin est l’élément
principal du système optique. Sa contraction éventuelle permet la modification
de la vergence V
de l’ensemble
-
La rétine est la couche
sensorielle où doit se former l’image pour obtenir une vision nette
b)-
L’œil normal au repos. Vision d’un objet
éloigné.
-
Un œil normal,
quand il n’accommode pas, voit nettement un objet situé à l’infini.
-
Quand l’œil est au repos (sans
accommodation), il met au point sur le « punctum remotum »,
PR
-
C’est le point le
plus éloigné pour lequel la vision est nette ; son image se forme sur la rétine.
-
La cornée
C
est à 4,0 mm de la face A du cristallin dont l’épaisseur est
AB
= 4,0 mm
-
La longueur
CR
= 23 mm
-
Application
:
-
Indiquer où doit se
trouver le foyer image de l’œil lorsque ce dernier, au repos, vise à l’infini ?
-
Position du foyer image de l’œil
au repos :
-
L’objet étant à l’infini, l’image
se forme dans le plan focal image.
-
Le foyer image doit être sur la
rétine
-
OA’ =
f’0
= OF’
-
Faire un schéma.
c)-
L’accommodation.
-
On rappelle que
pour une vision nette, l’image doit se former sur la rétine.
-
Pour lire son journal, situé à 25 cm du centre optique
O, Monsieur
X doit faire un effort d’accommodation. Son cristallin devient plus
bombé.
-
Application :
-
Faire un schéma du
dispositif.
-
Schéma réalisé avec le logiciel
Cabri Géomètre II
1)-
L’appareil photographique :
a)-
Description et schéma.
-
C’est un instrument
d’optique qui permet de former l’image d’un objet.
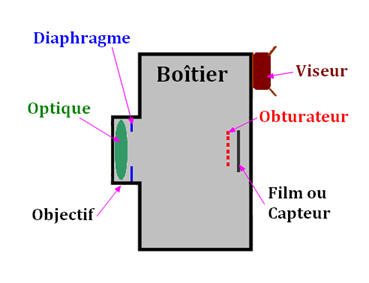
-
Schéma :
b)-
Le
modèle de l’appareil photographique.
-
En simplifiant, on peut résumer le
mécanisme de l’appareil photographique :
-
Le diaphragme permet de régler
l’énergie lumineuse qui pénètre dans l’appareil photographique
-
L’objectif peut être assimilé à
une lentille convergente L à laquelle on appliquera les
lois des lentilles minces.
-
Quand on règle l’appareil pour
obtenir une image nette, la vergence de cette lentille varie.
-
Pour voir nettement, un objet, il
faut que l’image se forme sur le film ou le capteur situé derrière la lentille
L.
-
Schéma simplifié :
|
1)-
Exercice 3 page 270 : Représenter les points caractéristiques.
2)-
Exercice 3 page 270 : Comprendre la construction d’une image. 3)-
Exercice 5 page 270 : Construire une
image. 4)-
Exercice 6 page 270 : Le grandissement. 5)-
Exercice 10 page 271 : Le projecteur de
diapositives. 6)-
Exercice 11 page 271 : Défaut de l’œil. 7)-
Exercice 15 page 272 : Exercice à
caractère expérimental.
9)-
Exercice 17 page 272 : Accommodation de l’œil.
10)-
Exercice 19 page 272 : Formation d’une image sur la rétine.
11)-
Exercice 21 page 274 : Les lentilles liquides. |
|
|