|
|
Émission et propagation d’un son. Cours |
|
|
|
|
|
I-
Émission et propagation d’un signal sonore.
|
|
1)- Représentation temporelle d’un signal périodique.
|
|
1)-
Exercice 5 page 216 :
Comparer des valeurs de vitesse. 2)-
Exercice 6 page 216 :
Déterminer la période d’un signal sonore. 3)-
Exercice 8 page 217 :
Calculer un domaine de fréquence. 4)-
Exercice 9 page 217 :
Représenter un domaine de fréquences. 5)-
Exercice 13 page 217 : Relier
des grandeurs. 6)-
Exercice 14 page 217 :
Évaluer une exposition sonore. 7)-
Exercice 17 page 218 :
L’oreille humaine 8)-
Exercice 18 page 218 :
Accorder une guitare avec un diapason. 9)- Exercice 24 page 220 : Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. 10)-
Exercice 26 page 221:
Propagation du son et température de l’air. 11)-
Exercice 29 page 222 : DS
Test d’audiométrie tonale.
|
I-
Émission et propagation d’un signal sonore.
1)- Émission d’un signal sonore.
-
Mis en vibration, un
objet émet un signal sonore.
-
Pour que ce signal
sonore soit
audible, il faut l’amplifier.
-
Pour ce faire, on
utilise le plus souvent une caisse de résonance.
-
Exemple : la
contrebasse
-
Lorsque l’on fait
vibrer les cordes d’une contrebasse, celles-ci produisent un son.
-
Ce son est alors
amplifié par le corps de la contrebasse qui fait office de caisse de résonance.
2)- Propagation d’un signal sonore.
-
Son émis par un
haut-parleur :
-
Lorsqu’un haut-parleur
est soumis à une tension périodique, sa membrane vibre.
-
Cela crée une
vibration de l’air qui se propage de proche en proche sans transfert de
matière : c’est une onde sonore.
-
Schéma d’un
haut-parleur :
-
Propagation d’un son :
-
Les molécules qui
constituent l’air vibrent et transmettent ce mouvement de proche en proche aux
molécules voisines.
-
Quelques points
importants :
-
Un signal sonore a
besoin d’un milieu matériel pour se propager.
![]() Un signal sonore se
propage dans un milieu matériel solide, liquide ou gazeux mais ne se propage pas
dans le vide.
Un signal sonore se
propage dans un milieu matériel solide, liquide ou gazeux mais ne se propage pas
dans le vide.
-
Les vitesses de
propagation d’un signal sonore dépendent du milieu matériel de propagation.
-
On parle aussi de la
célérité d’un son.
-
La valeur approchée de
la vitesse de propagation d’un signal sonore dans l’air à environ 20 ° C est :
-
v
≈
340 m / s.
-
cette vitesse dépend
de la température.
-
La célérité du son
dépend du milieu de propagation.
-
La célérité du son est
plus grande dans les solides que dans les liquides et le gaz.
-
Car moins le milieu
est compressible, plus il est difficile à déformer et plus il est rigide.
-
Plus il est rigide,
plus grande est sa célérité.
-
Tableau de
comparaison :
-
Comparaison de cette
valeur avec d’autres valeurs de vitesse.
|
|
Faucon
pèlerin
en
piqué |
Avion
de
ligne |
Son dans
l’air |
Son
dans l’eau
liquide |
Concorde
2 |
Son
dans l’acier
solide |
Lumière
dans l’air ou
le vide |
|
Valeur
approchée
de la
vitesse
(m . s–1) |
50 |
250 |
345 |
1500 |
1530 |
5000 |
3,00 ×108 |
|
1,4×10–1 |
7,2×10–1 |
1 |
4,3 |
4,4 |
1,4 ×101 |
8,7 ×105 |
3)- Caractéristiques d’un signal sonore périodique.
Un phénomène périodique est un
phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps
réguliers.
-
Exemple :
-
Signal émis lors de la
réalisation d’un audiogramme :
b)-
Période et fréquence :
-
La période
T
d’un phénomène périodique est la durée au bout de laquelle le phénomène se
reproduit identique à lui-même.
-
L’unité de période
T
est la seconde, symbole s.
-
La fréquence
f représente le nombre de période par
seconde. On écrit :
-
![]()
-
unité
de fréquence : Hertz : symbole Hz
-
Remarque : Pour
obtenir la fréquence en Hz, il faut pour cela exprimer la période en seconde s.
c)-
Enregistrement d’un signal
sonore
-
C’est la
représentation temporelle du signal électrique, de la tension
u =
f (t),
obtenue à l’aide d’un microphone.
-
Exemple :
-
L’analyse du signal
délivré par un microphone qui capte cette onde sonore montre que les vibrations
captées par le récepteur ont la même fréquence
f
que celle de la tension
périodique appliquée aux bornes du
H.P.
-
L’analyse du signal délivré par le
GBF
et du signal reçu par le microphone montre que les vibrations captées par le
récepteur ont la même fréquence
f que celle de la tension périodique.
d)-
Tension maximale, tension
minimale : Amplitude
- Pour une tension périodique u (t), la tension maximale Umax désigne la valeur la plus élevée prise par u (t) au cours du temps.
- La tension minimale Umin
est sa valeur la plus faible.
-
L’amplitude de la
tension représente l’écart entre sa valeur maximale et sa valeur moyenne.
-
Application :
-
Déterminer, pour le
signal suivant :
-
les valeurs de
Umax
et Umin
-
La
valeur de l’amplitude
A:
-
Sa
période T
et sa fréquence f.
-
Umax
≈ 50 mV et
Umin
≈ - 50 mV
-
Remarque : Umax
= – Umin
la tension est dite symétrique.
-
Comme la tension
est symétrique, la valeur moyenne est nulle pour cette tension.
-
A
= Umax ≈ 50 mV
-
C’est un cas
particulier fréquent.
-
On peut
déterminer aussi la valeur de la période
T
et ainsi la valeur de la fréquence
f.
-
Période du signal :
-
5
T
≈ 2,0 ms
=>
T ≈ 0,40 ms
-
Fréquence du signal :
-
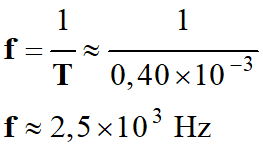
-
L’oreille humaine est
un récepteur sensible aux ondes sonores dont la fréquence est comprise entre
20 Hz et 20 kHz.
-
Domaines des ondes
sonores :
-
Les sons émis par deux
cordes différentes d’une guitare n’ont pas la même fréquence.
-
Ils n’ont pas la même
hauteur.
-
Plus la hauteur d’un
son est grande, plus sa fréquence est élevée et plus le son est aigu.
-
D’autre part, plus un
son est grave et plus sa fréquence est basse.
-
Le timbre d’un son
dépend du nombre et de l’amplitude des harmoniques qui sont présents.
-
Deux sons de même
hauteur émis par des instruments différents ne sont pas perçus de la même
manière, car les harmoniques, associées au fondamental, sont différentes.
-
L’analyse spectrale
d’un son musical permet de caractériser :
-
La hauteur du son qui
est liée à la fréquence f1
du fondamental
-
Le timbre du son qui
est lié au nombre et à l’amplitude des harmoniques présentes.
-
Le timbre du son émis dépend de l'instrument de musique mais aussi du point
d'attaque.
3)- Intensité et niveau d’intensité sonore.
-
Le niveau d’intensité
sonore est lié à l’amplitude du signal sonore.
-
Plus
l’amplitude du signal sonore est élevée plus l’intensité sonore
I
est grande.
-
L’intensité sonore,
notée I,
caractérise l’intensité du signal reçue par l’oreille.
-
Elle
s’exprime en watt par mètre carré : W / m2
ou W. m–2
-
L’oreille humaine
normale perçoit les signaux sonores dont l’intensité est comprise entre
-
Une valeur minimale
I0
= 1,0 × 10–12 W. m–2
(seuil d’audibilité)
-
Et une valeur maximale
Imax
= 25 W. m–2 (seuil de
douleur).
- Comme l’écart entre ces deux valeurs est très grand, on a créé une nouvelle grandeur, qui utilise une échelle logarithmique :
- Appelée le niveau
d’intensité sonore, notée
L.
-
Le
niveau d’intensité sonore L s’exprime en décibel dB
-
L’intensité sonore I
et le niveau d’intensité sonore L varient dans le même sens.
-
Quand
I
augmente, L
augmente.
-
Le niveau d’intensité
sonore se mesure avec un sonomètre.
-
Remarque : l’intensité sonore
I n’est pas proportionnelle au niveau
d’intensité sonore
L.
-
Échelles de I
et
L :
-
Remarque : les valeurs de
L (dB) sont plus faciles à manipuler
que les valeurs de
I (W. m–2)
-
Plus le niveau
d’intensité sonore et la durée d’exposition sont élevés et plus les risques
d’atteinte de l’audition sont importants.
-
Remarque :
-
Lorsque plusieurs
instruments de musique jouent ensemble, les intensités sonores
I dues à chaque
instrument s’ajoutent, alors que les niveaux d’intensité sonore
L ne s’ajoutent
pas.
-
L’exposition sonore
tient compte du niveau d’intensité sonore et de la durée d’exposition auxquels
l’oreille est soumise.
-
Une
exposition sonore trop élevée peut avoir des
conséquences irréversibles,
comme une surdité partielle, voire totale.
-
Une exposition sonore
de quelques secondes à un niveau d’intensité sonore L supérieur à 120 dB peut
entraîner une surdité totale et c’est irréversible.
1)- Représentation temporelle d’un signal périodique.
-
Un microphone permet
de convertir un signal sonore en un signal électrique.
-
Cette tension a la
même période que le signal sonore.
-
L’analyse de la
représentation temporelle du signal électrique permet d’étudier le signal
sonore.
-
Trois signaux sonores
sont émis. Ils ont pour fréquence
a.
f1
= 8,0 × 102 Hz
b.
f2
= 4,0 × 102 Hz
c.
f3
= 2,0 × 102 Hz
-
Les signaux
électriques obtenus lors de l’acquisition de ces trois signaux sonores sont
représentés ci-dessous.
-
Exploiter chaque
signal pour déterminer la valeur de la période et en déduire la valeur de la
fréquence sur l’oscillogramme.
-
Faire attention aux
réglages.
-
Étude
de l’enregistrement a.
-
Valeur de la période
du signal : exploitation de l’oscillogramme :
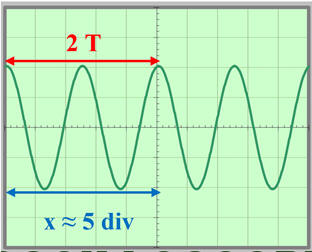
-
Durée de balayage :

►
Durée de balayage :
b
= 0,50 ms / div
-
Pour
deux périodes, x ≈ 5 div
-
2 T
= x
. b
-
2
T
≈ 2,5 × 0,50
-
T
≈ 1,25 ms
-
On en déduit la
fréquence du signal :
-
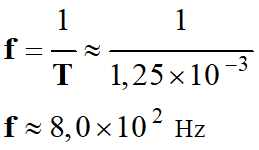
-
Ce résultat est en
accord avec la valeur du signal a. avec f1
= 8,0 × 102 Hz
-
Étude
de l’enregistrement b.
-
Valeur de la période
du signal : exploitation de l’oscillogramme :
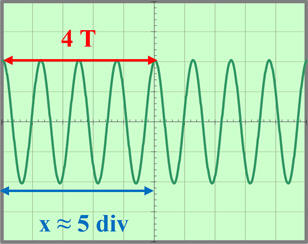
-
Durée de balayage :

►
Durée de balayage :
b
= 2 ,0 ms / div
-
Pour
quatre périodes, x ≈ 5 div
-
4
T =
x
. b
-
4
T
≈ 5,0 × 2,0
-
T
≈ 2,5 ms
-
On en déduit la
fréquence du signal :
-
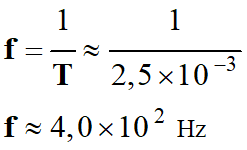
-
Ce
résultat est en accord avec la valeur du signal
b.
avec f2
= 4,0 × 102 Hz
-
Étude de
l’enregistrement c.
-
Valeur de la période
du signal : Exploitation de l’oscillogramme :
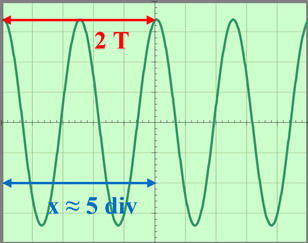
-
Durée de balayage :

►
Durée de balayage :
b
= 2 ,0 ms / div
-
Pour
deux périodes, x ≈ 5 div
-
2
T =
x
. b
-
2
T
≈ 5,0 × 2,0
-
T
≈ 5,0 ms
-
On en déduit la
fréquence du signal :
-
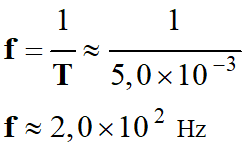
-
Ce
résultat est en accord avec la valeur du signal
c.
avec f3
= 2,0 × 102 Hz
|
1)-
Exercice 5 page 216 :
Comparer des valeurs de vitesse. 2)-
Exercice 6 page 216 :
Déterminer la période d’un signal sonore. 3)-
Exercice 8 page 217 :
Calculer un domaine de fréquence. 4)-
Exercice 9 page 217 :
Représenter un domaine de fréquences. 5)-
Exercice 13 page 217 : Relier
des grandeurs. 6)-
Exercice 14 page 217 :
Évaluer une exposition sonore. 7)-
Exercice 17 page 218 :
L’oreille humaine 8)-
Exercice 18 page 218 :
Accorder une guitare avec un diapason. 9)- Exercice 24 page 220 : Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons. 10)-
Exercice 26 page 221:
Propagation du son et température de l’air. 11)-
Exercice 29 page 222 : DS
Test d’audiométrie tonale.
|
|
|