|
Les lentilles |
|
|
|
|
|
|
II-
Les relations
de conjugaison et de grandissement. |
|
III-
Le
lien entre la position de l’objet et les caractéristiques de l’image.
1)-
Premier cas : l’objet
AB
est situé avant le foyer objet
F. 2)-
Deuxième cas : L’objet
AB est situé en le foyer
objet
F
et le centre optique
O. |
|
1)- TP : Relations pour une lentille mince
convergente.
2)- L’appareil photographique et l’œil.
|
|
Exercices :
1)- Exercice 04 page 314 :
Estimer une distance focale.
2)- Exercice 06 page 314 :
Utiliser la relation de conjugaison (1).
3)- Exercice 07 page 314 :
Utiliser la relation de conjugaison (2)
4)- Exercice 08 page 315 :
Calculer le grandissement.
5)- Exercice 09 page 315 :
Utiliser la formule du grandissement.
6)- Exercice 10 page 315 :
Distinguer image virtuelle d’image réelle.
7)- Exercice 16 page 316 :
Prévoir les caractéristiques d’une image.
8)- Exercice 24 page 318 :
Un mini-projecteur.
9)- Exercice 25 page 318 :
Focométrie.
10)- Exercice 27 page 318 :
Côté maths
11)- DS 01 : exercice 28
page 319 : Appareil photographique instantané.
12)- DS 02 : Exercice 29
page 319 : Où la lentille est-elle ?
|
1)- Modélisation d’une
lentille mince convergente.
a)-
Représentation symbolique
d’une lentille mince convergente.
-
Une lentille mince
est caractérisée par trois points particuliers :
-
Son centre optique
O ;
-
Son foyer image F’ ;
-
Son foyer objet F.
-
Représentation
symbolique :
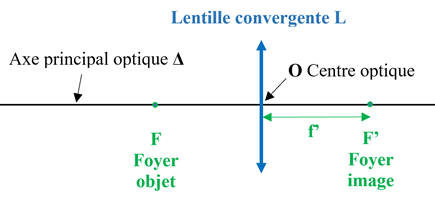
-
La
distance
focale
d’une lentille convergente :
-
La distance focale f' est définie comme la distance entre le
centre optique O
et chacun des foyers F
et F’.
![]()
- C'est une grandeur positive pour une lentille convergente.
-
Le
foyer objet
F et le
foyer image
F’ sont symétriques
par rapport au centre optique O.
-
f’ =
OF’ =
OF
![]()
-
La loi du retour inverse de la lumière permet de dire
que tout rayon passant par F,
symétrique de F’
par rapport au centre optique O
émerge parallèlement à l’axe optique Δ.
b)-
Construction d’une image
réelle :
-
Application :
-
Données : Diamètre
de la lentille : 6,0 cm
-
Distance focale : f’
= 2,0 cm
-
L’objet est
perpendiculaire à l’axe optique.
-
Objet AB
= 1,0 cm
-
L’objet AB
est situé avant le foyer-objet à 1,5 cm du foyer-objet.
-
Réaliser la
construction en utilisant la méthode suivante :
-
Rayon
1 :
issu du point B
et passant par le centre optique : il n’est pas dévié.
-
Rayon
2 :
issu du point B
et parallèle à l’axe optique. Il émerge de la lentille en passant
par le point F’
foyer - image.
-
Rayon 3 :
issu du point B
et passant par F
(foyer - objet). Il émerge de la lentille parallèlement à l’axe optique.
-
Les mesures :
-
f’ = 2,0 cm
-
AF = 1,5 cm
-
AB = 1,0 cm
-
A’B’ ≈ 1,3 cm
-
Remarques :
-
Les trois rayons se coupent en
B’ image de
B.
-
L’image A’
de A est la
projection orthogonale de B’
sur l’axe principal.
-
L’objet AB
est réel et l’image A’B’
est réelle et renversée.
-
Dans le cas
présenté, l’image est plus grande que l’objet.
-
La construction de l’image
A’B’ permet de
déterminer graphiquement sa position, sa taille et son sens.
2)- Repère associé à un
lentille mince convergente.
-
On choisit un
repère
R
(O,
x,
y)
-
L’origine est le
point
O,
centre optique de la lentille.
-
L’axe des abscisses
x
est l’axe optique
Δ
de la lentille. Il est orienté dans le sens de propagation de la lumière.
-
L’axe des ordonnées
y est l’axe perpendiculaire à l’axe optique
Δ,
passant par le centre optique
O
de la lentille. Il est orienté vers le
haut.
-
Ainsi,
-
La position de
l’objet
AB
et celle de l’image
A’B’ sont respectivement repérées par les abscisses
xA de
A et
xA’
de
A’.
-
Schéma :
Repérage de la position de l’objet et de
son image
II-
Les relations
de conjugaison et de grandissement.
1)- Position et taille de
l’image.
a)-
Approche de la relation.
-
La position de
l’image est liée à la position de l’objet par rapport à la lentille et à la
distance focale de la lentille.
-
Il est possible,
par le calcul, de prévoir le résultat de la construction géométrique de l’image.
-
Pour cela, on
utilise le repère
R
(0,
x,
y)
associé à la lentille mince convergente.
-
La position de
l’objet
AB
et celle de l’image
A’B’ sont respectivement repérées par les abscisses
xA de
A et
xA’
de
A’.
-
Les abscisses
xA et
xA’,
la distance focale
f’
de la lentille, ne sont pas indépendantes.
-
Elles sont reliées
par une relation appelée : relation de conjugaison.
b)-
Relation de conjugaison :
-
Formule de
conjugaison avec les notations choisies :
-

-
Remarque :
-
Les grandeurs
xA,
xA’
et
f’
doivent être exprimées dans la même unité de longueur.
c)-
Relation de conjugaison et
formule de Descartes :
-
Cette relation fait
intervenir les mesures algébriques :
-
Formule de conjugaison
avec les mesures algébriques :
-
![]()
-
Formule de
Descartes :
-

-
Formule de
conjugaison qui fait intervenir les coordonnées liées au repère associé à la
lentille :
-

-
Schéma de la
situation :
-
Retrouver cette relation en utilisant le fait que les
triangles OBA
et OB’A’
d’une part et HOF’
et B’A’F’
d’autre part sont homothétiques (Théorème de Thalès).
Et
-
Remarque : H
est la projection orthogonale de B
sur la lentille.
-
Les triangles OBA
et OB’A’
sont homothétiques, d’après Thalès :
-
 (1)
(1)
-
Les triangles HOF’
et B’A’F’
sont homothétiques, d’après Thalès :
-

-
En combinant (1),
(2) et (3), il vient :
-

-
En utilisant le
fait que :
-

-
En identifiant les
différents termes de la relation :
-

d)-
Grandissement de l’image :
-
Le grandissement
d’une lentille est donné par la relation :
-
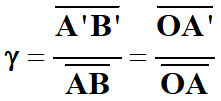
-
Avec le repère lié
à la lentille mince convergente :
-
![]() et
et ![]()
-
Le grandissement de
l’image est donné par la relation suivante :
- 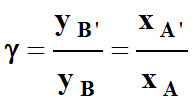
-
Remarques :
-
La grandeur
γ
est un nombre qui n’a pas d’unité.
-
C’est une grandeur
algébrique : elle peut être positive ou négative.
-
Si
γ
>
0
l’image a le même sens que l’objet, on dit qu’elle est
droite.
-
Si
γ
<
0
l’image est de sens contraire à l’objet, on
dit qu’elle est
renversée.
-
Si |
γ
| >1, l’image est plus grande que l’objet.
-
Si|
γ
| <1 , l’image est plus petite que l’objet.
e)-
Conclusion :
-
La
position,
la taille
et le
sens
de l’image sont
les caractéristiques de l’image.
-
Elles peuvent être
déterminées graphiquement ou par le calcul à partir des relations de conjugaison
et du grandissement.
-
Les
caractéristiques de l’images dépendent des caractéristiques de la lentille et
des caractéristiques de l’objet.
f)-
Comment
déterminer la valeur de la distance focale
f’
d’une lentille mince convergente ?
-
Soit
f’
la distance focale d’une lentille mince convergente.
-
La relation de
conjugaison est la suivante.
- 
-
Si on vise un objet
AB
suffisamment éloigné de la lentille,
-
Le terme
xA devient très grand et le terme
![]() tend vers zéro
tend vers zéro
-
En conséquence,
-

-
La distance entre
la lentille et l’image est pratiquement égale à la distance focale de la
lentille.
-
Image du Soleil
donné par une lentille mince convergente :
-
Une lentille, dont
l’axe optique est dirigé vers le Soleil, donne sur un écran une tache quasi
ponctuelle très lumineuse.
-
Cette tache
représente l’image du Soleil (Attention
ça chauffe).
-
On peut considérer
que le Soleil est une source lumineuse située à l’infini.
-

-
La distance entre
la lentille et l’image est pratiquement égale à la distance focale de la
lentille.
-
On a ainsi une idée
de l’ordre de grandeur de la distance focale de la lentille.
-
Pour que l’image
d’un objet se forme sur la rétine d’un œil ou sur le capteur d’un appareil
photographique, il faut réaliser une mise au point.
-
Pour ce faire, on
peut :
-
Modifier la
distance focale de la lentille,
-
Modifier la
distance de l’objet à la lentille,
-
Modifier la
distance de la lentille à l’écran.
III-
Le lien entre
la position de l’objet et les caractéristiques de l’image.
1)- Premier cas : l’objet
AB est situé avant le
foyer objet
F.
a)-
Schéma de la situation :
b)-
Caractéristiques de l’image.
-
L’image formée à
travers la lentille peut être observée sur un écran
-
On dit que l’image
est
réelle :
xA’ > 0
-
Le grandissement
γ
<
0 : l’image
est renversée.
-
|
γ | <
1 , l’image
est plus petite que l’objet.
2)- Deuxième cas : L’objet
AB
est situé en le foyer
objet
F et le centre optique
O.
a)-
Schéma de la situation :
b)-
Caractéristiques de l’image.
-
L’image formée à
travers la lentille ne peut pas être observée sur un écran.
-
Ce sont les
prolongements des rayons 1, 2 et 3 qui se coupent en
B’
-
L’image est
virtuelle.
-
Elle ne se forme
pas sur un écran mais elle peut être vue par l’œil à travers le système optique.
-
Il faut placer
l’œil sur le chemin des rayons lumineux qui émergent du système optique.
-
Le grandissement
γ
>
0 :
elle est dite droite.
-
L’image est de même
sens que l’objet :.
-
|
γ | >
1 , l’image
est plus grande que l’objet.
c)-
Application : La loupe.
-
À l’aide d’une
loupe constituée par une lentille convergente de distance focale
f’
= 5,0 cm, un philatéliste observe les détails d’un timbre et, en particulier une
lettre de 0,10 mm de hauteur.
-
La lettre jouant le rôle d’objet
AB est placée au
foyer objet F
de la lentille.
-
L’œil de l’observateur, assimilable à un point, est
placé au foyer image F’
de la lentille.
Questions :
-
L’image A’B’
est-elle à l’infini ou à une distance finie de la lentille ?
Construction :
-
Tracer la marche de deux rayons issus du point
B, l’un parallèle à
l’axe optique et l’autre passant par le centre optique.
-
Tracer la marche
d’un faisceau s’appuyant sur les bords de la lentille.
-
Tracer la marche du rayon lumineux issu de
B’ et pénétrant
dans l’œil de l’observateur.
-
On place un objet
AB
de 1,0 cm de haut à 4,0 cm du centre optique.
-
Le point
A
est sur l’axe optique et
AB
est perpendiculaire à l’axe optique.
-
Construire l’image
A’B’ de
AB donnée
par la loupe ceci à l’échelle ½ pour la lentille mais pas pour l’objet.
-
Déterminer
graphiquement la position et la grandeur de l’image.
-
En déduire le
grandissement de la loupe dans cette situation.
-
Donner les
caractéristiques de l’image.
-
Retrouver les
grandeurs
xA et
xA’
et
yB et
yB’
à l’aide des formules de conjugaison.
-
Peut-on recueillir cette image sur un écran
?
Réponses :
-
Position de l’image
A’B’ :
-
Comme
l’objet est placé au foyer objet de la lentille convergente, l’image est située
à l’infinie.
-
Schéma :
-
Le rayon 1 et le
rayon 2 sont parallèles.
-
Construction :
-
Le tracé des deux rayons issus du point
B, l’un parallèle à
l’axe optique et l’autre passant par le centre optique :
-
Le tracé de la
marche d’un faisceau s’appuyant sur les bords de la lentille.
-
Le tracé de la marche du rayon lumineux issu de
B’ et
pénétrant dans l’œil de l’observateur.
-
Construction de l’image
A’B’
de AB donnée
par la loupe ceci à l’échelle ½ pour la lentille mais pas pour l’objet.
-
Détermination
graphique de la position et de la grandeur de l’image :
-
Position de
l’image :
-
xA’ ≈ – 20 cm
et
yB’ ≈
5,0 cm
-
Taille de l’image :
A’B’ ≈ 5,0 cm
-
Le grandissement de
l’image est donné par la relation suivante :
-

-
Caractéristiques de
l’image :
-
L’image est
virtuelle.
-
Le grandissement
γ
>
0 :
elle est dite droite.
-
|
γ | >
1 , l’image
est plus grande que l’objet.
-
Les grandeurs
xA et
xA’
et
yB et
yB’
-
La formule de
conjugaison :
- 
-
Grandissement de
l’image :
- 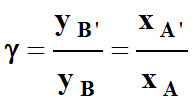
-
Données initiales :
-
f’
= 5,0 cm ; xA = – 4,0 cm ;
yB
= 1,0 cm
-
Schéma de la
situation :

-
Comme l’objet est
situé entre le foyer objet et le centre optique, l’image se trouve à gauche de
la lentille.
-
Valeur de
xA’ :
-

-
Valeur de yB’
:
-
On utilise la
relation du grandissement de l’image :
- 
-
Schéma final :
-
L’image formée à
travers la lentille ne peut pas être observée sur un écran.
-
Ce sont les
prolongements des rayons lumineux qui se coupent en
B’
-
L’image est
virtuelle.
-
Elle ne se forme
pas sur un écran mais elle peut être vue par l’œil à travers le système optique.
-
Il faut placer
l’œil sur le chemin des rayons lumineux qui émergent du système optique.
1)- TP : Relations pour une
lentille mince convergente.
2)- L’appareil
photographique et l’œil.
a)-
L’appareil photographique.
-
C’est un instrument
d’optique qui permet de former l’image d’un objet.
-
Schéma :
-
Le modèle de
l’appareil photographique.
-
En simplifiant, on
peut résumer le mécanisme de l’appareil photographique :
-
Le diaphragme
permet de régler l’énergie lumineuse qui pénètre dans l’appareil photographique
-
L’objectif peut être assimilé à une lentille
convergente L
à laquelle on appliquera les lois des lentilles minces.
-
Quand on règle
l’appareil pour obtenir une image nette, la vergence de cette lentille varie.
-
Pour voir nettement, un objet, il faut que l’image se
forme sur le film ou le capteur situé derrière la lentille
L.
-
Schéma simplifié :
b)-
L’œil.
-
L’œil peut être
assimilé à une sphère, de 2,3 cm de diamètre, limitée par une membrane très
résistante et sombre : la sclérotique.
-
Schéma :

►
Comme dans le cas des
instruments d’optique, on retrouve :
-
Un ensemble optique
assurant la formation des images.
-
Les rayons lumineux
traversent une succession de milieux transparents d’indices de réfraction
différents :
-
La cornée (n =
1,376),
-
L’humeur aqueuse (n
= 1,337), le cristallin (n = 1,437 : il a la forme d’une lentille biconvexe),
l’humeur vitrée (n = 1,337).
-
La pupille,
ouverture circulaire (dont le diamètre varie de 2 mm à 8 mm), joue le rôle de
diaphragme.
-
Elle règle le flux
lumineux.
-
La rétine, membrane
tapissée de cellules photosensibles (cônes et bâtonnets), joue le rôle de
récepteur de lumière.
►
Modèle de l’œil.
-
En simplifiant, on
peut résumer le mécanisme de vision de l’œil ainsi :
-
La pupille joue le
rôle de diaphragme
-
L’ensemble {cristallin + cornée} peut être assimilé à
une lentille convergente L
à laquelle on appliquera les lois des lentilles minces.
-
Quand on
« accommode », la vergence de cette lentille augmente.
-
Pour voir nettement, un objet, il faut que l’image se
forme sur la rétine située 17 mm derrière la lentille
L.
-
Faire un schéma du
dispositif expérimental permettant de modéliser l’œil.
-
Indiquer les
dimensions.
-
Schéma :
|
Œil |
Modélisation |
Appareil photo |
|
Pupille |
Diaphragme |
Diaphragme |
|
Cristallin -
cornée |
Lentille
convergente |
Optique |
|
Rétine |
Écran |
Capteur |
-
Remarque :
-
Au cours de la séance de travaux pratiques, on
modélise un œil normal au repos à l’aide d’un tube cylindrique, de longueur
ℓ1,
aux extrémités duquel sont fixés une lentille convergente et un écran (verre
dépoli ou papier translucide).
-
Pour fabriquer
l’œil modélisé normal, on place l’écran (la rétine) à 17 cm de la lentille.
|
1)- Exercice 04 page 314 :
Estimer une distance focale.
2)- Exercice 06 page 314 :
Utiliser la relation de conjugaison (1).
3)- Exercice 07 page 314 :
Utiliser la relation de conjugaison (2)
4)- Exercice 08 page 315 :
Calculer le grandissement.
5)- Exercice 09 page 315 :
Utiliser la formule du grandissement.
6)- Exercice 10 page 315 :
Distinguer image virtuelle d’image réelle.
7)- Exercice 16 page 316 :
Prévoir les caractéristiques d’une image.
8)- Exercice 24 page 318 :
Un mini-projecteur.
9)- Exercice 25 page 318 :
Focométrie.
10)- Exercice 27 page 318 :
Côté maths
11)- DS 01 : exercice 28
page 319 : Appareil photographique instantané.
12)- DS 02 : Exercice 29
page 319 : Où la lentille est-elle ?
|
|
|